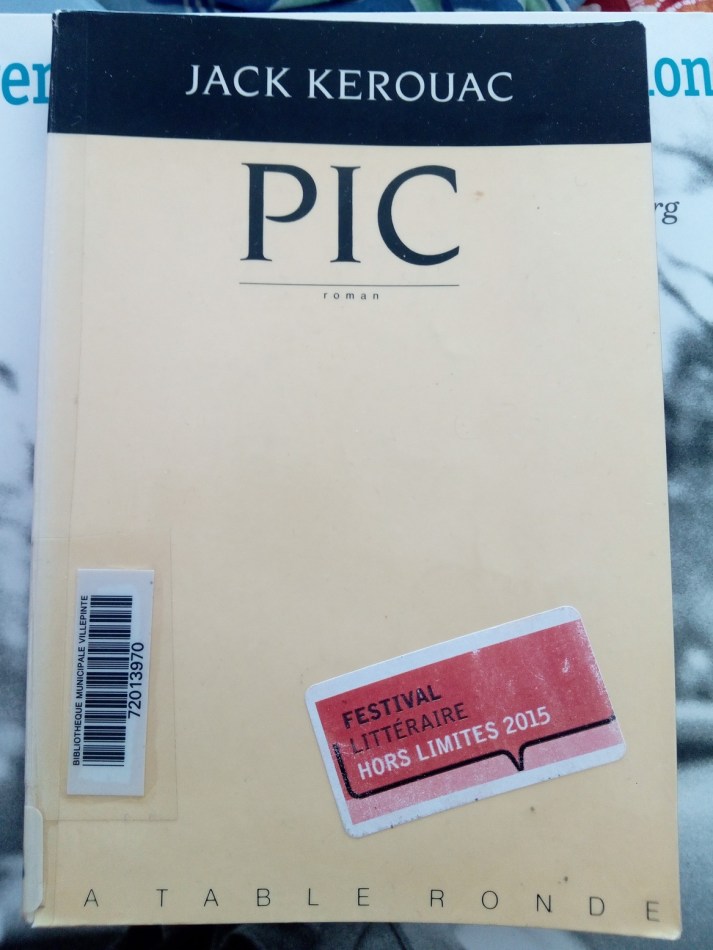« Jadis sous le soleil rouge – ce fou de Cody, dont ceci est l’histoire, oyez braves gens. »
Jack Kerouac : Visions de Cody
« Visions of Cody is a bizarre book with a bizarre history. »
Aaron Latham, New York Times, 28 Janvier 1973.
***
Difficile de résumer ou d’analyser un livre comme les Visions de Cody de Jack Kerouac. En ce qui me concerne, c’est le seul ouvrage de l’auteur que je n’ai jamais conseillé à qui que ce soit. Non pas que je ne l’apprécie pas, je le trouve génial, mais il ne s’adresse à mon avis qu’aux kerouakiens avertis, aux dingues de la Beat Generation et aux allumés au chômage qui auront le temps de se plonger dans ce long récit déstructuré qui se joue de la flèche du temps, se fiche de l’ennui qu’il peut procurer aux lecteurs et dont le seul fil rouge est Cody Pomeray/Dean Moriarty/Neal Cassady, et encore.
Écrit en 1951-1952 sous influence de benzédrine, la drogue du moment aux États-Unis, dont Kerouac n’hésitait pas à user et abuser, Visions de Cody est un roman expérimental se voulant, selon l’auteur lui-même, « une étude de caractère […] du héros de Sur La Route, Dean Moriarty, dont le nom est désormais Cody Pomeray. »
Ce Dean Moriarty devenu Cody Pomeray est en fait, évidemment, Neal Cassady, le meilleur ami de Jack dans les années 50, un ex-délinquant juvénile venu du Colorado qui a débarqué dans la bande de Kerouac à New York en 1947. Avec Neal, Jack a passé des nuits entières à écouter du bop en picolant dans les bars, il a traversé l’Amérique d’est en ouest, voyagé jusqu’au Mexique et vécu mille aventures qui constitueront la base de son œuvre littéraire.
Neal l’enfant sauvage est tout ce que Jack rêve d’être, un type spontané qui n’a peur de rien, amoureux de la vie, séducteur, vivant l’instant présent à fond sans se soucier du lendemain, et il l’admire tellement qu’il va écrire les sept cents pages des Visions pour lui, alors qu’il travaille en même temps sur La Route, qui lui est aussi presque entièrement consacrée.
« Il évoquait une doublure d’Hollywood qui boxe à la place du héros avec un tel acharnement lointain, anonyme et vicieux […] que tout le monde commence à s’interroger, car le vrai héros ne se comporterait manifestement pas ainsi dans cette irréalité réelle. »
***
Réputé impubliable malgré les énormes succès de Kerouac en librairie, Visions de Cody ne sortira qu’en 1972 et ni son auteur ni son héros ne vivront assez longtemps pour le savoir, Jack décédant en 1969 des suites d’une cirrhose alcoolique, et Neal en 1967, le nez dans la neige, après une soirée trop arrosée d’acides. Il paraît que lorsqu’on lui a annoncé la nouvelle, Jack n’a pas voulu croire au décès de Neal, et il aurait longtemps maintenu que son ami (qu’il ne voyait pourtant plus beaucoup à cette époque) avait mis en scène sa mort pour ne pas avoir à payer les pensions alimentaires qu’il devait à ses ex-femmes…
Dans les Visions, Cody Pomeray/Neal Cassady est au-delà de l’héroïsme, il est un objet de fascination (et d’étude) là où il n’était que le meilleur ami dans Sur La Route. Ses faits et gestes sont mythifiés et chacune de ses paroles est lourde de sens, plusieurs longs sketchs décrivent même des épisodes de sa jeunesse et de son enfance, que Kerouac invente avec un luxe de détails stupéfiant.
Les sketchs, ce sont ces plus ou moins longs paragraphes de retranscriptions d’événements, de descriptions du décor, d’analyses du comportement de badauds dans la ville, qui constituent la première partie du livre (les deux premiers chapitres). Ici les néons d’une enseigne de cinéma de quartier, là les toilettes pour homme du métro aérien, plus loin la cliente d’une cafétéria new-yorkaise puis le jazzman Lee Konitz qui va traîner chez un disquaire ; et partout Cody Pomeray le Fameux, parfois reniflant dans une ruelle grise en proie à mille pensées, d’autres fois juste étant passé par ici, hier ou il y a dix ans.
Si vous n’avez pas stoppé votre lecture au bout de trente pages, c’est déjà que vous aimez bien le style Kerouac, mais attendez un peu la suite.
N’importe quel kerouakien débutant sait à quel point Jack était obsédé par l’envie de relater avec le plus de justesse possible les événements qu’il avait vécu, s’attachant le plus souvent à des détails infimes comme un reflet sur le capot d’une bagnole, les raies de lumières dans l’entrebâillement d’une porte, une fissure sur le trottoir ou un mot prononcé avec un drôle d’accent dans une conversation, mais rien ne nous avait préparé à la deuxième partie du livre : La bande. Deux cents pages de retranscriptions, au mot près, de cinq nuits de discussions enregistrées au magnétophone avec Jack, Neal et quelques autres.
La première fois que j’ai lu les Visions, il y a une douzaine d’années, ce chapitre m’avait paru interminable et j’avais bien failli renoncer. Étrangement, en le relisant cette année, je n’ai pas vécu les mêmes souffrances. La raison en est sûrement que je connais désormais beaucoup mieux les dingues qui figurent sur la bande, leurs discussions bizarres & leurs histoires étranges ne me sont plus tout à fait incompréhensibles, je les ai déjà plus ou moins entendu dans d’autres livres. Cela fait, il est vrai, un bon moment que je me familiarise avec les membres historiques de la Beat Generation, la description détaillée de leurs soirées de défonce m’évoque donc beaucoup plus de choses qu’avant, peut-être même de manière exagérée… En tout cas, cela me conforte dans l’idée que ce livre n’est recommandable qu’aux Beats convaincus !
Ceux qui, néanmoins, arriveront jusqu’au chapitre Imitation de la bande – juste après l’enregistrement de l’émission religieuse avec le prêcheur et les fidèles en transe – découvriront alors ce qui était réellement impubliable dans ce livre car, à partir de là, comme l’écrit Allen Ginsberg dans la préface, K. a entièrement renoncé à la littérature américaine pour laisser libre le cours à son esprit.
La dinguerie et la liberté d’écriture dont fait preuve Jack dans cette dernière partie du livre (environ deux cent cinquante pages) n’est comparable qu’à ses recueils de poésie ou à Vieil Ange de Minuit. Tout est mis sens dessus dessous, Kerouac réécrit la bande du magnétophone mais il y insère également une sorte de version ultra-rapide de Sur La Route avant de mettre en scène sa propre pendaison par deux fois tandis que Joan Rawshanks dans le brouillard joue la comédie sous les projecteurs dans les rues de San Francisco. Voilà exactement ce qui se passe.
Mais Jack étant Kerouac, toute cette affaire ne pouvait que se terminer par une apothéose : le récit de son voyage au Mexique avec Neal Cassady et Frank Jeffries et une scène finale qui est en fait la même que celle de Sur La Route, mais réécrite, le tout raconté d’une manière si fulgurante, puissante et émouvante que cela constitue, selon moi, un des sommets de la carrière du King of the Beats.
***
Pour conclure, Visions de Cody est ouvrage inclassable, long et exigeant qui a toutes les qualités et les défauts pour être classé comme « chef d’œuvre illisible » – comme je l’ai lu récemment à propos de L’Infinie Comédie de David Foster Wallace – dans la bibliothèque de ceux qui utilisent ce genre de qualificatif pompeux. Novateur et barré tout enétant capable de nous tirer des émotions, il réussit à être à la fois futuriste et nostalgique, un peu comme un film en images de synthèse en noir et blanc… À moins que tout celane soit au final qu’un des principes de la prose spontanée, théorisée par Kerouac lui-même, poussée à son paroxysme : Pas de pause pour penser au mot juste mais l’accumulation enfantine et scatologique de mots concentrés jusqu’à ce que la satisfaction soit atteinte, ce qui finira par être une grande valeur rythmique ajoutée et sera en accord avec la Grande Loi du Tempo.
Voilà, j’espère vous avoir bien exposé les dangers qu’il y a à se lancer dans la lecture des Visions de Cody de Jack Kerouac. Si dès lors vous souhaitiez quand même vous y risquer, merci de ne pas me tenir responsable des éventuels effets secondaires (confusion, ennui, illumination…) qui pourraient en découler. Je n’ai écrit cette chronique que dans un but préventif, évidemment.
La fumée monte au-dessus des rotondes et des ateliers où, le soir, on accroche des salopettes maculées de graisse à des clous, près des vestiaires, dans la lumière brune et triste… la lumière de Cody, du travail, de la nuit, les ténèbres de la paternité. Une bouteille de vin vide (Guild), une planche, un bout de carton d’une caisse de citrons, déchiré un wagon probablement chargé dans les cours tout aussi ensommeillées de La Nouvelle-Orléans, tout en bas du pays, avant de parcourir cette vieille terre folle de nos rêves – morceaux de métal rouillés sans nom, pièces de fer-blanc informes – Le Vieux Cody Pomeray n’est pas encore passé par ici ! – devant ces rails ultimes, ce tas de légumes avariés, la Côte sainte a disparu, la route sacrée s’achève.
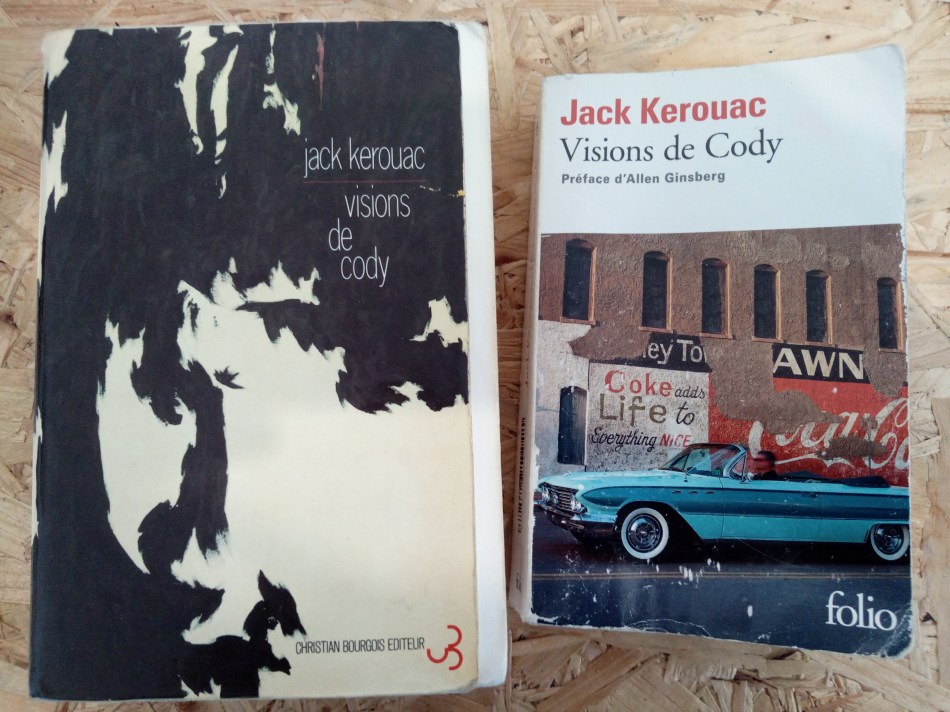
Manu – Zuunzug