
-
L’Orgie
. . .
-
La Grève des Électeurs

Un texte d’Octave Mirbeau écrit en 1888. Libre de droit et téléchargeable en PDF à cette adresse : https://infokiosques.net/IMG/pdf/lagrevedeselecteurs-2.pdf

La Grève Des Électeurs :
Une chose m’étonne prodigieusement – j’oserai dire qu’elle me stupéfie – c’est qu’à l’heure scientifique où j’écris, après les innombrables expériences, après les scandales journaliers, il puisse exister encore dans notre chère France (comme ils disent à la Commission du budget) un électeur, un seul électeur, cet animal irrationnel, inorganique, hallucinant, qui consente à se déranger de ses affaires, de ses rêves ou de ses plaisirs, pour voter en faveur de quelqu’un ou de quelque chose. Quand on réfléchit un seul instant, ce surprenant phénomène n’est-il pas fait pour dérouter les philosophies les plus subtiles et confondre la raison ?
Où est-il le Balzac qui nous donnera la physiologie de l’électeur moderne ? et le Charcot qui nous expliquera l’anatomie et les mentalités de cet incurable dément ? Nous l’attendons.
Je comprends qu’un escroc trouve toujours des actionnaires, la Censure des défenseurs, l’Opéra-Comique des dilettanti, le Constitutionnel des abonnés, M. Carnot des peintres qui célèbrent sa triomphale et rigide entrée dans une cité languedocienne ; je comprends M. Chantavoine s ’obstinant à chercher des rimes ; je comprends tout. Mais qu’un député, ou un sénateur, ou un président de République, ou n’importe lequel parmi tous les étranges farceurs qui réclament une fonction élective, quelle qu’elle soit, trouve un électeur, c’est-à-dire l’être irrêvé, le martyr improbable, qui vous nourrit de son pain, vous vêt de sa laine, vous engraisse de sa chair, vous enrichit de son argent, avec la seule perspective de recevoir, en échange de ces prodigalités, des coups de trique sur la nuque, des coups de pied au derrière, quand ce n’est pas des coups de fusil dans la poitrine, en vérité, cela dépasse les notions déjà pas mal pessimistes que je m’étais faites jusqu’ici de la sottise humaine, en général, et de la sottise française en particulier, notre chère et immortelle sottise, ô chauvin !
Il est bien entendu que je parle ici de l’électeur averti, convaincu, de l’électeur théoricien, de celui qui s’imagine, le pauvre diable, faire acte de citoyen libre, étaler sa souveraineté, exprimer ses opinions, imposer – ô folie admirable et déconcertante – des programmes politiques et des revendications sociales ; et non point de l’électeur « qui la connaît » et qui s’en moque, de celui qui ne voit dans « les résultats de sa toute-puissance » qu’une rigolade à la charcuterie monarchiste, ou une ribote au vin républicain. Sa souveraineté à celui-là, c’est de se pocharder aux frais du suffrage universel. Il est dans le vrai, car cela seul lui importe, et il n’a cure du reste. Il sait ce qu’il fait. Mais les autres ?
Ah ! oui, les autres ! Les sérieux, les austères, les peuple souverain, ceux-là qui sentent une ivresse les gagner lorsqu’ils se regardent et se disent : « Je suis électeur ! Rien ne se fait que par moi. Je suis la base de la société moderne. Par ma volonté, Floque fait des lois auxquelles sont astreints trente-six millions d’hommes, et Baudry d’Asson aussi, et Pierre Alype également. » Comment y en a-t-il encore de cet acabit ? Comment, si entêtés, si orgueilleux, si paradoxaux qu’ils soient, n’ont-ils pas été, depuis longtemps, découragés et honteux de leur œuvre ? Comment peut-il arriver qu’il se rencontre quelque part, même dans le fond des landes perdues de la Bretagne, même dans les inaccessibles cavernes des Cévennes et des Pyrénées, un bonhomme assez stupide, assez déraisonnable, assez aveugle à ce qui se voit, assez sourd à ce qui se dit, pour voter bleu, blanc ou rouge, sans que rien l’y oblige, sans qu’on le paye ou sans qu’on le soûle ?
À quel sentiment baroque, à quelle mystérieuse suggestion peut bien obéir ce bipède pensant, doué d’une volonté, à ce qu’on prétend, et qui s’en va, fier de son droit, assuré qu’il accomplit un devoir, déposer dans une boîte électorale quelconque un quelconque bulletin, peu importe le nom qu’il ait écrit dessus ?… Qu’est-ce qu’il doit bien se dire, en dedans de soi, qui justifie ou seulement qui explique cet acte extravagant ?
Qu’est-ce qu’il espère ? Car enfin, pour consentir à se donner des maîtres avides qui le grugent et qui l’assomment, il faut qu’il se dise et qu’il espère quelque chose d’extraordinaire que nous ne soupçonnons pas. Il faut que, par de puissantes déviations cérébrales, les idées de député correspondent en lui à des idées de science, de justice, de dévouement, de travail et de probité ; il faut que dans les noms seuls de Barbe et de Baihaut, non moins que dans ceux de Rouvier et de Wilson, il découvre une magie spéciale et qu’il voie, au travers d’un mirage, fleurir et s’épanouir dans Vergoin et dans Hubbard, des promesses de bonheur futur et de soulagement immédiat. Et c’est cela qui est véritablement effrayant. Rien ne lui sert de leçon, ni les comédies les plus burlesques, ni les plus sinistres tragédies.
Voilà pourtant de longs siècles que le monde dure, que les sociétés se déroulent et se succèdent, pareilles les unes aux autres, qu’un fait unique domine toutes les histoires : la protection aux grands, l’écrasement aux petits. Il ne peut arriver à comprendre qu’il n’a qu’une raison d’être historique, c’est de payer pour un tas de choses dont il ne jouira jamais, et de mourir pour des combinaisons politiques qui ne le regardent point.
Que lui importe que ce soit Pierre ou Jean qui lui demande son argent et qui lui prenne la vie, puisqu’il est obligé de se dépouiller de l’un, et de donner l’autre ? Eh bien ! non. Entre ses voleurs et ses bourreaux, il a des préférences, et il vote pour les plus rapaces et les plus féroces. Il a voté hier, il votera demain, il votera toujours. Les moutons vont à l’abattoir. Ils ne se disent rien, eux, et ils n’espèrent rien. Mais du moins ils ne votent pas pour le boucher qui les tuera, et pour le bourgeois qui les mangera. Plus bête que les bêtes, plus moutonnier que les moutons, l’électeur nomme son boucher et choisit son bourgeois. Il a fait des Révolutions pour conquérir ce droit.
Ô bon électeur, inexprimable imbécile, pauvre hère, si, au lieu de te laisser prendre aux rengaines absurdes que te débitent chaque matin, pour un sou, les journaux grands ou petits, bleus ou noirs, blancs ou rouges, et qui sont payés pour avoir ta peau ; si, au lieu de croire aux chimériques flatteries dont on caresse ta vanité, dont on entoure ta lamentable souveraineté en guenilles, si, au lieu de t’arrêter, éternel badaud, devant les lourdes duperies des programmes ; si tu lisais parfois, au coin du feu, Schopenhauer et Max Nordau, deux philosophes qui en savent long sur tes maîtres et sur toi, peut-être apprendrais-tu des choses étonnantes et utiles. Peut-être aussi, après les avoir lus, serais-tu moins empressé à revêtir ton air grave et ta belle redingote, à courir ensuite vers les urnes homicides où, quelque nom que tu mettes, tu mets d’avance le nom de ton plus mortel ennemi. Ils te diraient, en connaisseurs d’humanité, que la politique est un abominable mensonge, que tout y est à l’envers du bon sens, de la justice et du droit, et que tu n’as rien à y voir, toi dont le compte est réglé au grand livre des destinées humaines.
Rêve après cela, si tu veux, des paradis de lumières et de parfums, des fraternités impossibles, des bonheurs irréels. C’est bon de rêver, et cela calme la souffrance. Mais ne mêle jamais l’homme à ton rêve, car là où est l’homme, là est la douleur, la haine et le meurtre. Surtout, souviens-toi que l’homme qui sollicite tes suffrages est, de ce fait, un malhonnête homme, parce qu’en échange de la situation et de la fortune où tu le pousses, il te promet un tas de choses merveilleuses qu’il ne te donnera pas et qu’il n’est pas d’ailleurs, en son pouvoir de te donner. L’homme que tu élèves ne représente ni ta misère, ni tes aspirations, ni rien de toi ; il ne représente que ses propres passions et ses propres intérêts, lesquels sont contraires aux tiens. Pour te réconforter et ranimer des espérances qui seraient vite déçues, ne va pas t’imaginer que le spectacle navrant auquel tu assistes aujourd’hui est particulier à une époque ou à un régime, et que cela passera. Toutes les époques se valent, et aussi tous les régimes, c’est-à-dire qu’ils ne valent rien. Donc, rentre chez toi, bonhomme, et fais la grève du suffrage universel. Tu n’as rien à y perdre, je t’en réponds ; et cela pourra t’amuser quelque temps. Sur le seuil de ta porte, fermée aux quémandeurs d’aumônes politiques, tu regarderas défiler la bagarre, en fumant silencieusement ta pipe.
Et s’il existe, en un endroit ignoré, un honnête homme capable de te gouverner et de t’aimer, ne le regrette pas. Il serait trop jaloux de sa dignité pour se mêler à la lutte fangeuse des partis, trop fier pour tenir de toi un mandat que tu n’accordes jamais qu’à l’audace cynique, à l’insulte et au mensonge.
Je te l’ai dit, bonhomme, rentre chez toi et fais la grève.
Octave Mirbeau

. . .
-
« Journaux de bord 1947-1954 »

Les textes regroupés ici et présentés comme les « journaux de bord » de Jack Kerouac proviennent de carnets écrits par l’auteur entre 1947 et 1954. Si certains viennent clairement de ce qu’on peut appeler un journal de bord – on y suit jour après jour la vie et les réflexions de Kerouac – d’autres sont probablement plus à ranger dans la catégorie « brouillons » tant ils ressemblent à des premiers jets destinés à être retravaillés lors de la rédaction des futurs romans. Les sept années choisies couvrent une bonne partie du processus d’écriture de « The Town and The City » (1er roman de Kerouac, publié en 1950) mais aussi de « Sur La Route » et c’est bien évidemment là-dessus qu’on a le plus envie de s’attarder, comment Jack Kerouac a-t-il trouvé son style d’écriture, sa « prose spontanée » ?
Dans les pages des « Journaux de bord », Kerouac passe par tous les sentiments possibles, de la confiance absolue en ses talents d’écrivain au désespoir le plus total. Quiconque a lu quelques bouquins du bonhomme sait à quel point il était torturé, ce qu’on savait sûrement moins c’est à quel point il était bosseur, bûcheur, complètement obnubilé par sa destinée de grand auteur, s’astreignant d’innombrables nuits d’écriture, refusant d’aller voir ses amis et s’enfermant dans sa chambre pour écrire, écrire, inlassablement.
« The Town and The City » né dans la douleur mais quand il sort en librairie, Kerouac est déjà passé à autre chose, autre chose de vraiment grand… Dans la tête de Jack, ce premier roman est déjà du passé lorsqu’il est publié, et il en sera de même pour « Sur La Route » sept ans plus tard. Kerouac veut aller vite et il y va, beaucoup trop, ses sessions de travail sont homériques, ses cuites interminables. Dans ses carnets, il est vrai comme jamais, il écrit comme il pense et tout ce qu’il pense il l’écrit, ainsi sa façon de décrire Allen Ginsberg en 1948 :
« Il est enfermé à l’intérieur de lui-même d’une manière si désespérée qu’il en devient en fait une sorte de gargouille à la proue d’un vieux navire, et alors que le vieux navire progresse sur les eaux du monde entier, la gargouille, sans jamais dévier, grimace et ricane alors que le navire franchit des caps, traverse les mers du Sud, passe devant des icebergs et des albatros, entre prudemment dans des vieux ports crasseux, jette l’ancre dans des lagons fleuris, coule pour finir au fond de l’Océan, où, au milieu de la vase qui fait des bulles, des poissons bizarres et dans la lumière marine, la gargouille continue de grimacer et de ricaner, à jamais. Pourtant, ce n’est pas tout. »
Si vous trouvez ça saisissant – ça l’est – sachez que le reste est du même tonneau ! Les « Journaux de bord » n’ont rien à voir avec les pauvres « Underwood Memories », triste recueil des premiers essais littéraires de Kerouac publié en 2006 mais qui n’aurait probablement jamais dû voir le jour. Nous n’avons pas ici les premières nouvelles et les premiers articles de Jack, nous avons tout ce qu’il y a eu autour de « T&C » et de « Route » et c’est beaucoup, beaucoup plus intéressant. Entre une volée de fulgurances poétiques et quelques réflexions sur Dostoïevski, Kerouac y va même (et c’est assez rare pour être signalé) d’un ou deux couplets politiques :
« En Russie, ils triment pour l’état, ici ils triment pour la Consommation. Il n’y a pas la moindre différence nulle part… Les gens vont simplement se ruer vers des boulots qui n’ont aucun sens, jour après jour, vous les voyez en train de tousser dans le métro à l’aube, et ils ne se reposent jamais, ne se détendent jamais, ne profitent jamais de la vie, tout ce qu’ils font, c’est « couvrir leurs dépenses ». […] Je vous le dis, ils ne méritent rien d’autre que du mépris, et vous pouvez être sûr, naturellement, qu’ils seront prêts à partir pour une guerre exterminatrice que leurs dirigeants vicieux auront concoctée pour sauver les apparences. […] Après tout, qu’arriverait-il à notre précieuse société de consommation si nos exportations doivent faire face à la concurrence russe. Merde aux russes, merde aux américains, merde à tous. Je vais vivre à ma « manière paresseuse de vaurien », voilà ce que je vais faire. »
Dans ce qu’on pourrait appeler les « brouillons » de « Sur La Route », commencés dès 1948, on découvre non seulement les prémices de la prose spontanée kerouackienne mais aussi des événements, des réflexions, des émotions qui seront ensuite développés puis imprimés dans le roman. Le passage de la « mort à Denver » auquel on a droit au tout début de la troisième partie de « Route » prend ici la forme d’un sublime texte de quatre pages intitulé « Le Cœur et l’Arbre » (p. 323) et qui se termine ainsi :
« Le vieux Noir avait, dans la poche de sa veste, une canette de bière qu’il était en train d’ouvrir ; et le vieux Blanc jetait un regard envieux sur la canette & fouillait sa poche pour voir s’il avait de quoi s’en acheter une.
Oh, comme je suis mort, cette nuit là!
Là-bas à Denver, tout ce que j’ai fais, c’est mourir – jamais rien vu de pareil.
Je me suis éloigné en direction des rues muettes du centre de Denver, en direction du trolley de Colfax & Broadway ; où se trouve le grand bâtiment stupide du Capitole avec son dôme éclairé et ses pelouses bien tondues. Plus tard, j’ai marché sur les routes plongées dans le noir absolu du côté d’Alameda et je suis revenu à la maison qui m’avait coûté 1000 dollars pour rien, où ma sœur et mon beau-frère étaient assis à se faire du souci pour l’argent et le travail et l’assurance et la sécurité et tout ça… dans la cuisine carrelée de blanc. «Dans son carnet appelé « Pluie et Fleuves » – tout un programme – Kerouac entreprend de synthétiser et résumer ses différents voyages à travers les États-Unis pour en faire ce qui deviendra « Sur La Route », les connaisseurs du bouquin seront donc ravis de découvrir la matière qui a donné le livre de 1957, la sélection des textes est excellente et leur agencement donne, d’une certaine manière, l’impression de voir le roman prendre forme sous nos yeux.
Quel plaisir aussi de trouver, page 501, la première trace du texte qui deviendra plus tard la chanson « On The Road » / « Home I’ll Never », popularisée en 2006 par Tom Waits sur l’album « Orphans » et à laquelle je consacrerais le prochain article sur Jack Kerouac.
Pour finir, je pense que n’importe quel aficionado de Kerouac se doit de lire les « Journaux de bord 1947-1954 », tout ce qui fait Jack était déjà là, tout était déjà… dans sa tête.
« Il n’y a rien à écrire. Le seul homme qui semblait s’en soucier, George Martin, est mort et enterré. Je ne me souviens même pas si Leo Kerouac était véritablement comme ça.
Tout était dans ma tête. » (Août 1949)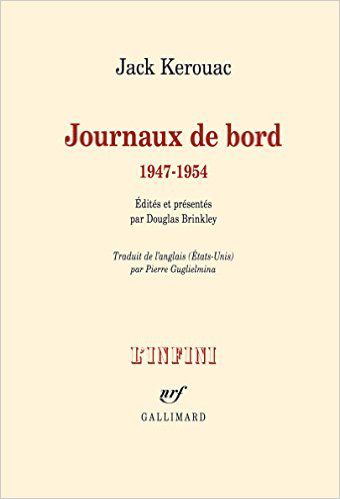
. . .