
-
Victor Jara
. . .
-
Nouvelle Rome

(Carte postale du vieux monde…)
L’air manque, les idées pourrissent, mon spectre reste sur le quai
Les yeux dans le vide à attendre le paquebot de la liberté
Revenu des mers agitées, de là où les vents soufflent fort
Sur ces peuples qui n’ont même plus le choix de la passivité
Ici pourtant c’est encore dans le calme et dans le silence
Que les plans de nos ennemis se mettent en place et avancent
Tranquillement, et le sang qui gicle sur les vitrines de la ville
N’inquiète pas pour le moment et c’est presque trop facile
Tout est chiffré, fruit d’équations, pourtant rien n’est logique
Même si tout ce qui nous concerne est transposable en numérique
Le meilleur de nos milliards de données analysées
Publicités sur mesure sous nos yeux, sur nos trajets
Les acteurs crèvent l’écran, sortent des tablettes, des iPhones
Des affiches dans les transports nous appellent par téléphone
La télévision t’agresse, te réclame dans ses programmes
S’invite à table, s’occupe des disputes familiales
Elle règle les débats, martèle les idées dominantes
Et sa vérité, quelle qu’elle soit, devient vite envahissante
Elle se hisse au sommet, devient décisionnaire
De ce que tu es en droit de penser et en devoir de faireDans la cité plébéienne, les ombres ploient sous la machine
Marchent au pas et chinent pour leur pitance quotidienne
Tout en haut de la montagne, les Romains observent
Et piochent dans les réserves…Tant de territoires explorés, en vain, de la boue dans nos cheveux
Et nous traînons encore et certains sont sur les genoux
Mais pour aller jusqu’où ? Vers le repentir ou la gloire,
La terreur ou la victoire, dans l’horreur ou dans l’espoir ?
Des ports arrivent les pires des vendeurs de mort
Contre un billet vert ou une action, tout le monde sort
Se rouler dans la fange et danser avec les loups
Ils pensent être libres mais sont mentalement dépendants de leurs gourous
Sous le joug d’idées de plus en plus nauséabondes
Même ma bande se rétrécit et fleurte avec l’immonde
Un monde aux pieds des puissants rêve d’une aube dorée
Ils sont déjà là même si tu cherches à les ignorer
Regarde-les prendre de l’assurance et grignoter le terrain
Recourir à la violence, tout ça a déjà été trop loin
Triste Europe rampante, vieux continent ignorant
Gouverné par la pègre et les populistes fascisants
Tandis que les capitaux circulent et que la dette se propage
Les maîtres de la finance mettent des actions sur le carnage
Le citoyen se délite, dans la finance se perd
Un crédit sur sa vie en guise de seul repèreDans la cité plébéienne, les ombres ploient sous la machine
Marchent au pas et chinent pour leur pitance quotidienne
Tout en haut de la montagne, les Romains observent
Et piochent dans les réserves…
. . .
-
« Journaux de bord 1947-1954 »

Les textes regroupés ici et présentés comme les « journaux de bord » de Jack Kerouac proviennent de carnets écrits par l’auteur entre 1947 et 1954. Si certains viennent clairement de ce qu’on peut appeler un journal de bord – on y suit jour après jour la vie et les réflexions de Kerouac – d’autres sont probablement plus à ranger dans la catégorie « brouillons » tant ils ressemblent à des premiers jets destinés à être retravaillés lors de la rédaction des futurs romans. Les sept années choisies couvrent une bonne partie du processus d’écriture de « The Town and The City » (1er roman de Kerouac, publié en 1950) mais aussi de « Sur La Route » et c’est bien évidemment là-dessus qu’on a le plus envie de s’attarder, comment Jack Kerouac a-t-il trouvé son style d’écriture, sa « prose spontanée » ?
Dans les pages des « Journaux de bord », Kerouac passe par tous les sentiments possibles, de la confiance absolue en ses talents d’écrivain au désespoir le plus total. Quiconque a lu quelques bouquins du bonhomme sait à quel point il était torturé, ce qu’on savait sûrement moins c’est à quel point il était bosseur, bûcheur, complètement obnubilé par sa destinée de grand auteur, s’astreignant d’innombrables nuits d’écriture, refusant d’aller voir ses amis et s’enfermant dans sa chambre pour écrire, écrire, inlassablement.
« The Town and The City » né dans la douleur mais quand il sort en librairie, Kerouac est déjà passé à autre chose, autre chose de vraiment grand… Dans la tête de Jack, ce premier roman est déjà du passé lorsqu’il est publié, et il en sera de même pour « Sur La Route » sept ans plus tard. Kerouac veut aller vite et il y va, beaucoup trop, ses sessions de travail sont homériques, ses cuites interminables. Dans ses carnets, il est vrai comme jamais, il écrit comme il pense et tout ce qu’il pense il l’écrit, ainsi sa façon de décrire Allen Ginsberg en 1948 :
« Il est enfermé à l’intérieur de lui-même d’une manière si désespérée qu’il en devient en fait une sorte de gargouille à la proue d’un vieux navire, et alors que le vieux navire progresse sur les eaux du monde entier, la gargouille, sans jamais dévier, grimace et ricane alors que le navire franchit des caps, traverse les mers du Sud, passe devant des icebergs et des albatros, entre prudemment dans des vieux ports crasseux, jette l’ancre dans des lagons fleuris, coule pour finir au fond de l’Océan, où, au milieu de la vase qui fait des bulles, des poissons bizarres et dans la lumière marine, la gargouille continue de grimacer et de ricaner, à jamais. Pourtant, ce n’est pas tout. »
Si vous trouvez ça saisissant – ça l’est – sachez que le reste est du même tonneau ! Les « Journaux de bord » n’ont rien à voir avec les pauvres « Underwood Memories », triste recueil des premiers essais littéraires de Kerouac publié en 2006 mais qui n’aurait probablement jamais dû voir le jour. Nous n’avons pas ici les premières nouvelles et les premiers articles de Jack, nous avons tout ce qu’il y a eu autour de « T&C » et de « Route » et c’est beaucoup, beaucoup plus intéressant. Entre une volée de fulgurances poétiques et quelques réflexions sur Dostoïevski, Kerouac y va même (et c’est assez rare pour être signalé) d’un ou deux couplets politiques :
« En Russie, ils triment pour l’état, ici ils triment pour la Consommation. Il n’y a pas la moindre différence nulle part… Les gens vont simplement se ruer vers des boulots qui n’ont aucun sens, jour après jour, vous les voyez en train de tousser dans le métro à l’aube, et ils ne se reposent jamais, ne se détendent jamais, ne profitent jamais de la vie, tout ce qu’ils font, c’est « couvrir leurs dépenses ». […] Je vous le dis, ils ne méritent rien d’autre que du mépris, et vous pouvez être sûr, naturellement, qu’ils seront prêts à partir pour une guerre exterminatrice que leurs dirigeants vicieux auront concoctée pour sauver les apparences. […] Après tout, qu’arriverait-il à notre précieuse société de consommation si nos exportations doivent faire face à la concurrence russe. Merde aux russes, merde aux américains, merde à tous. Je vais vivre à ma « manière paresseuse de vaurien », voilà ce que je vais faire. »
Dans ce qu’on pourrait appeler les « brouillons » de « Sur La Route », commencés dès 1948, on découvre non seulement les prémices de la prose spontanée kerouackienne mais aussi des événements, des réflexions, des émotions qui seront ensuite développés puis imprimés dans le roman. Le passage de la « mort à Denver » auquel on a droit au tout début de la troisième partie de « Route » prend ici la forme d’un sublime texte de quatre pages intitulé « Le Cœur et l’Arbre » (p. 323) et qui se termine ainsi :
« Le vieux Noir avait, dans la poche de sa veste, une canette de bière qu’il était en train d’ouvrir ; et le vieux Blanc jetait un regard envieux sur la canette & fouillait sa poche pour voir s’il avait de quoi s’en acheter une.
Oh, comme je suis mort, cette nuit là!
Là-bas à Denver, tout ce que j’ai fais, c’est mourir – jamais rien vu de pareil.
Je me suis éloigné en direction des rues muettes du centre de Denver, en direction du trolley de Colfax & Broadway ; où se trouve le grand bâtiment stupide du Capitole avec son dôme éclairé et ses pelouses bien tondues. Plus tard, j’ai marché sur les routes plongées dans le noir absolu du côté d’Alameda et je suis revenu à la maison qui m’avait coûté 1000 dollars pour rien, où ma sœur et mon beau-frère étaient assis à se faire du souci pour l’argent et le travail et l’assurance et la sécurité et tout ça… dans la cuisine carrelée de blanc. «Dans son carnet appelé « Pluie et Fleuves » – tout un programme – Kerouac entreprend de synthétiser et résumer ses différents voyages à travers les États-Unis pour en faire ce qui deviendra « Sur La Route », les connaisseurs du bouquin seront donc ravis de découvrir la matière qui a donné le livre de 1957, la sélection des textes est excellente et leur agencement donne, d’une certaine manière, l’impression de voir le roman prendre forme sous nos yeux.
Quel plaisir aussi de trouver, page 501, la première trace du texte qui deviendra plus tard la chanson « On The Road » / « Home I’ll Never », popularisée en 2006 par Tom Waits sur l’album « Orphans » et à laquelle je consacrerais le prochain article sur Jack Kerouac.
Pour finir, je pense que n’importe quel aficionado de Kerouac se doit de lire les « Journaux de bord 1947-1954 », tout ce qui fait Jack était déjà là, tout était déjà… dans sa tête.
« Il n’y a rien à écrire. Le seul homme qui semblait s’en soucier, George Martin, est mort et enterré. Je ne me souviens même pas si Leo Kerouac était véritablement comme ça.
Tout était dans ma tête. » (Août 1949)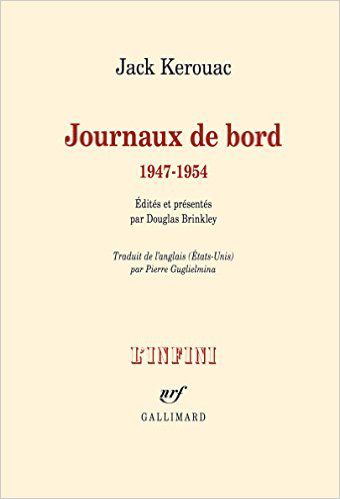
. . .